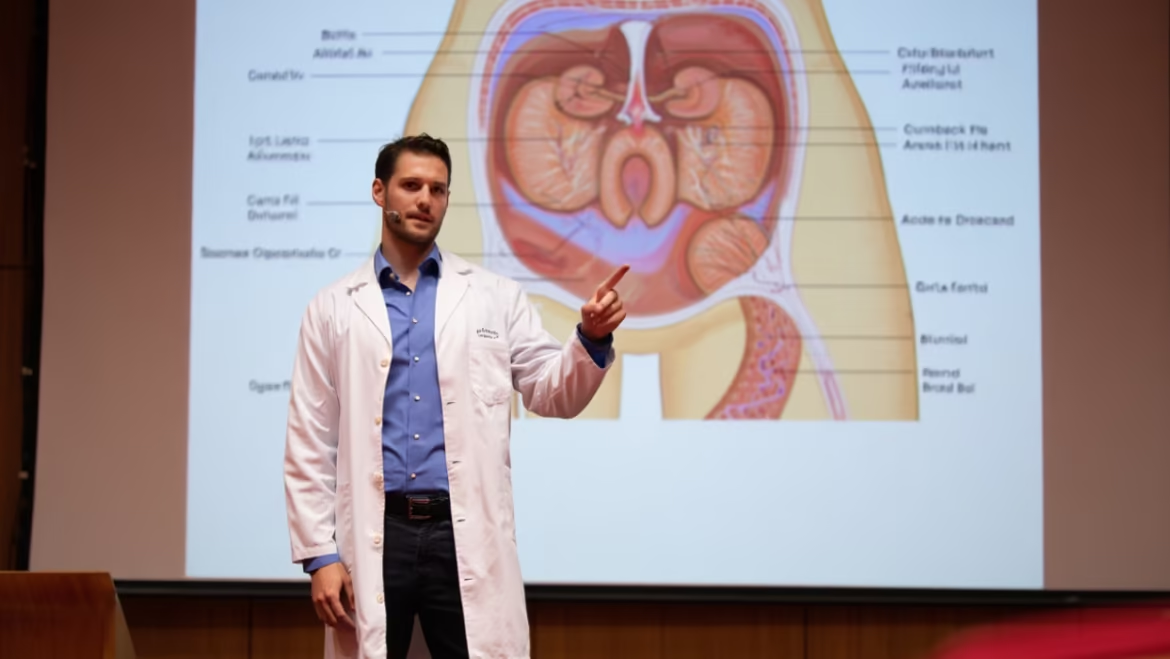Cette technique orgasmique méconnue mérite d’être testée (au moins une fois !)
Quand on parle de plaisir féminin, on évoque souvent le fameux point G, ce Graal caché sur la paroi antérieure du vagin qui agite les fantasmes… Mais saviez-vous qu’il existait un autre point de plaisir, tout aussi puissant, pourtant encore largement méconnu : le point A ? Aussi appelé zone AFE (Anterior Fornix Erogenous zone) dans la littérature scientifique, il se trouve plus en profondeur, et peut être responsable de sensations intenses, voire d’orgasmes à répétition. Intrigué·e ? On vous explique tout.
Qu’est-ce que le point A ?
Situé au fond du vagin, sur la paroi antérieure, juste entre le col de l’utérus et la vessie, le point A se trouve au-delà du point G. Il est associé à une zone du vagin hautement innervée et vascularisée, ce qui en fait un point central à explorer pour certaines femmes en quête de nouveaux plaisirs sexuels. Cette zone a été identifiée comme potentiellement très sensible par plusieurs études en sexologie, notamment chez les femmes sujettes aux orgasmes vaginaux répétés .
Pourquoi stimuler le point A ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le point A ne fonctionne pas de la même manière que le point G. S’il est stimulé doucement et avec lubrification, il peut :
- favoriser la lubrification naturelle.
- intensifier la profondeur des sensations.
- conduire à un orgasme profond et durable.
- être une solution pour les femmes qui ressentent peu de plaisir via le clitoris ou le point G.
Selon certaines études, la stimulation de cette zone pourrait également améliorer la qualité des rapports sexuels pour les femmes souffrant de sécheresse vaginale ou de certaines formes de dysfonctionnements sexuels .
Comment trouver et stimuler le point A ?
Pas besoin d’un GPS, mais un peu de curiosité et de communication suffisent. Pour explorer le point A :
- Choisissez un moment détendu, sans pression.
- Couchez-vous sur le dos, genoux légèrement relevés.
- Insérez un doigt (ou un sextoy courbé), paume tournée vers le haut.
- Poussez lentement vers le fond du vagin, jusqu’à sentir une zone plus douce ou spongieuse, à environ 7 à 10 cm de l’entrée : c’est là que vous êtes.
💡 L’usage d’un lubrifiant est fortement recommandé pour éviter toute gêne, car la profondeur de cet endroit le rend moins naturellement lubrifié.
🧠 Et surtout : écoutez votre corps. Toutes les femmes ne sont pas sensibles au point A, ou n’y trouvent pas le même plaisir. L’exploration reste la clé !
Avec ou sans partenaire ?
La stimulation du point A peut très bien se faire en solo, à l’aide d’un sextoy adapté (avec une courbure spécifique, style « point G profond »), ou avec un.e partenaire. Cette pratique renforce souvent l’intimité et encourage la communication sexuelle dans le couple. Certains couples expérimentent également des positions profondes, comme la levrette ou l’Andromaque inversée, pour un accès facilité à cette zone.
Le point A, un tabou qui se lève ?
Encore peu discuté dans les médias traditionnels, le point A mérite pourtant une vraie place dans les conversations autour du plaisir féminin. À mesure que la sexualité se libère et que les tabous tombent, de plus en plus de femmes témoignent de nouveaux types d’orgasmes liés à cette zone encore mystérieuse.
Et si l’on changeait notre regard sur le plaisir en élargissant le champ des possibles ?
En résumé :
- Le point A est une zone érogène profonde, située après le point G.
- Sa stimulation peut entraîner des orgasmes intenses et améliorer la lubrification naturelle.
- Il reste encore peu connu, mais suscite un intérêt croissant chez les sexologues.
- Il se découvre avec délicatesse, seul·e ou à deux, dans l’objectif de mieux connaître son corps.
📚 Sources – Études
Addiego, F. et al. (1981). « Female ejaculation: A case study ». Journal of Sex Research, 17(1), 13–21.
Chivers, M. et al. (2007). « A field guide to female sexual response ». Journal of Sex & Marital Therapy.
Ostrzenski, A. (2012). « G-Spot anatomy: newly discovered presence of the G-Spot in the anterior vaginal wall ». Journal of Sexual Medicine, 9(3), 972–979.